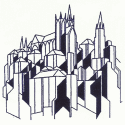Thil- Esch sur Alzette et Bascharage - 30 septembre 2025
La matinée débuta par la visite de l’ancien camp de travail de Thil sous la conduite de M. Gino Bersaco, adjoint au maire. Pour la très grande majorité du groupe, ce fut une découverte. Son existence est due à la destruction du site de production de Peenemünde (en Poméranie) par l’aviation alliée en 1943. Les nazis cherchèrent d’autres sites, plus en sécurité pour la production de V1 (missiles), de V2 (fusées) et de moteurs d’aviation Porsche. Ils trouvèrent dans la mine de fer du Tiercelet, l’endroit adéquat car s’ouvrant à flanc de coteau. Aussi fut construit à proximité (1km) un camp d’internement de déportés juifs hongrois mais aussi de femmes soviétiques réquisitionnées pour l’aménagement et les terrassements (800 personnes au total). Au lendemain de la guerre, les nombreux témoignages des habitants ont permis de constituer une mémoire précise des conditions de travail et de vie des détenus. Des peintures et croquis ont même été réalisés par des artistes locaux alors que les traces du camp s’effaçaient peu à peu.
Nous cheminâmes le long d’une allée bordée de sculptures contemporaines rappelant aux générations actuelles la souffrance qu’endurèrent ces malheureux. Du camp d’origine, ne subsistent que deux poteaux marquant l’entrée du camp. La crypte bâtie en 1946 en pierre de taille jaune contient une maquette présentant l’ensemble des installations, de nombreuses photographies d’époque, l’urne contenant les cendres de l’unique personne (une femme) incinérée dans le camp et le four, provenant des abattoirs de Villerupt ayant servi à la crémation. Les corps des nombreux détenus décédés, sans qu’on en connaisse le nombre exact, par suite des conditions de travail pénibles, de sous alimentation voire d’autres causes, étaient envoyés au Struthof pour y être incinérés, à l’exception de deux, brûlés à l’extérieur du camp à l’aide de bois et de mazout.
Le guide nous livra un certain nombre d’anecdotes recueillies au lendemain de la guerre auprès des villageois. Chaque matin, les détenus devaient quitter leur baraquement avec une grosse pierre sur le dos, qu’ils devaient déposer à l’entrée de la mine située à un kilomètre de distance. Un comptage permettait aux gardiens de s’assurer que tout le monde était bien là. Le soir, la même opération était effectuée dans l’autre sens. En matière d’enterrement de villageois, les règles étaient très strictes, car le cimetière communal surplombait le camp. Le cortège devait s’arrêter à l’entrée de la zone et deux personnes seulement pouvaient accompagner le corbillard jusqu’au cimetière avec l’interdiction absolue de détourner le regard vers le camp, au risque de se prendre des rafales de mitraillettes.
Nous n’eûmes pas la possibilité de voir la mine du Tiercelet ayant servi d’usine souterraine, en l’absence de conditions de sécurité assurées. Mais le guide nous raconta que les femmes étaient contraintes de forer la mine pour l’installation matérielle. Un jour, un pan entier s’est effondré écrasant une trentaine d’entre elles. Les femmes bénéficiaient d’un traitement moins brutal que les hommes. Ainsi à l’occasion du 1er mai 1944, certaines arborèrent un foulard rouge (fête du travail). Les sanctions allaient du cachot aux coups de fouet. Un groupe de détenus parvint pourtant à s’évader malgré la surveillance constante des détenus. Ce fut le seul cas enregistré. Le guide nous précisa que l’évacuation du camp le 1er septembre 1944, motivée par l’approche des troupes américaines, s’est faite dans la précipitation. Il nous fit remarquer que le béton coulé sur place était de couleur noire, preuve, selon lui, que des rampes de lancement de fusées devaient voir le jour.
Nous nous rendîmes ensuite à Esch-sur-Alzette où nous attendaient deux guides, Jean Goedert (ancien architecte de la ville) et Maryléna qui prirent chacun un demi-groupe. Le petit village d’Esch (810 hab. en 1821) qui tirerait son nom de la présence d’eau, se mua en ville avec l’exploitation du minerai de fer au début des années 1840 et l’installation de centres sidérurgiques. Trois importants sites industriels s’implantèrent dans les années qui suivirent, attirant de nombreux ouvriers (25 000 à l’époque de la plus grande prospérité) qu’il fallait loger, nourrir, divertir... De nos jours, les sites ont été délaissés de leur fonction d’origine mais - et c’est tout l’enjeu des politiques urbaines contemporaines - les vieux bâtiments sont intégrés dans de nouveaux quartiers d’habitation, de commerce et de centre culturel. Par exemple, le quartier autour de l’ancien site de Terres Rouges est ainsi devenu un centre très animé avec de nombreux cafés et logements locatifs, surtout peuplés de travailleurs immigrés italiens. Les guides nous ont vanté la mue profonde de Belval aujourd’hui siège de l’université de Luxembourg, disposant d’un grand centre commercial et de nombreux bars et restaurants. Un quartier à visiter, nous ont-ils dit, sous la conduite de guides locaux ! Les guides nous ont montré les plans du tout nouveau quartier projeté sur l’emplacement d’un des trois sites industriels dont quelques éléments seront maintenus en place avec leur architecture en briques.
Le parcours commun aux deux demi-groupes s’établit entre les places de l’Hôtel de Ville et de la Résistance. La rue empruntée, rue de l’Alzette, longue de 800m, fut créée à partir de la fin de XIXe siècle pour permettre à l’ancien bourg de s’ouvrir avec des nouveaux quartiers mais aussi de revêtir les habits d’une véritable ville moderne, centrée sur les commerces. Les nombreux édifices dont on put admirer la diversité de styles des façades portent le témoignage des années 1900-1930. En faire l’inventaire serait fastidieux tant les architectes ont apporté leur touche personnelle sur des projets de propriétaires fortunés (commerçants ou banquiers) empreints des références de plusieurs styles de cette époque jusqu’à être présents, le plus souvent, sur une même façade. On y retrouve du néo-gothique, du néo-classique (hôtel de ville devant lequel se dresse chaque année le marché de Noël), de l’art nouveau, de l’art déco et, plus surprenant encore, des décors Louis XVI ! Pour obtenir le résultat attendu, les autorités urbaines durent canaliser et enfouir dans le sol, l’Alzette qui s’écoulait à l’emplacement de la rue (d’où son nom).
Tandis que l’un des groupes se dirigeait ensuite vers l’église du Sacré Cœur tout en art déco, l’autre groupe fut conduit à l’église néo-gothique Saint Joseph (1873). Mais Esch a aussi une synagogue contemporaine (l’ancienne ayant été détruite par les nazis), deux églises protestantes et une mosquée.
Les visites se terminèrent place de la Résistance (communément appelée Brillplatz) où se tient le musée de la Résistance Nationale et des Droits de l’Homme. Il bénéficia d’un réaménagement complet depuis 2013 mais par manque de temps, nous ne le visitâmes pas. En face se tenait le restaurant où des plats typiquement luxembourgeois nous furent servis. Le dessert fut particulièrement apprécié.
Un court déplacement nous projeta dans l’univers de la bière luxembourgeoise où nos deux guides passionnés nous présentèrent l’histoire de la Brasserie Nationale, née de la fusion en 1975 des deux plus anciennes brasseries luxembourgeoises, Punck-Bricher (fondée en 1764) et Bofferding (fondée en 1842). En 2004, la Brasserie rachète Battin. L’ensemble de la production est concentrée à Bascharage. C’est la plus grande brasserie du Luxembourg (125 000 litres /jour) qui commercialisent ses produits sous les marques Bofferding, Funck-Bricher et Battin mais également de l’eau minérale Lodyss.
Nous eûmes droit aux explications parfois très pointues sur la technique de fabrication de la bière dont on retiendra que le processus part du malt issu de l’orge et de l’eau d’une qualité extra (il faut 6 à 8l d’eau pour un litre de bière), auxquels on ajoute du houblon pour l’amertume, les arômes, l’aseptisation et la digestibilité et des levures naturelles pour la fermentation alcoolique mais également pour donner du goût et un parfum. Après avoir bien « moussé » nos esprits, nos guides nous mirent l’eau à la bouche par une dégustation d’un verre de Lodyss avant de nous offrir l’occasion de déguster plusieurs bières en fin de parcours.
Un grand merci à tous les guides de la journée !
Gérard Colotte
Photographies : Dominique Mayer