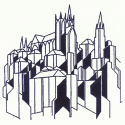SPIRE, mardi 28 octobre 2025
Le début de notre parcours vers le Rhin s’effectua par une pluie intermittente qui nous fit craindre le pire car l’essentiel de la journée devait se faire à l’extérieur. Il n’en fut rien et sitôt parvenus sur les bords du fleuve, nous eûmes droit pour la journée, certes, à un défilé ininterrompu de nuages, mais à aucune averse.
Nous pûmes ainsi partir à la découverte du Technik Museum, entièrement consacré aux transports. Chacun eut à loisir de cheminer sur les 80 000m2 d’exposition et de monter à bord d’un 747 – perché à 20m du sol- ou d’un sous-marin U-Boot U9 ou bien encore d’un Antonov AN-22, le plus gros transporteur de fret en son temps et dans la navette spatiale Bourane. Le « tarmac » de l’exposition était en fait bien plus riche en machines en tous genres : bateaux, hélicoptères, locomotives à vapeur …
Nos yeux purent admirer aussi, dans un immense hangar – la Liller Halle – nombre de voitures de course comme une Porsche 356 C (1964) ou une BMW Isetta (1955) ou plus classiques (Peugeot des années 30) et même quelques véhicules d’avant 1914. Notre regard fut porté également vers des voitures au design très particulier comme la «Jet Dragster « Funny Car » (1995) ou encore un camion à l’allure futuriste et pourtant fabriqué en 1995 (Colani Truck MB).
Le musée est récent ; il a ouvert ses portes en 1991 mais son histoire remonte à 1913. Nous sommes alors à Lille, bien loin de Spire. Une usine de Thomson Houston produit du matériel électrique pour les tramways. Lorsque les Allemands envahissent et occupent toute la région du Nord pendant la Première Guerre mondiale, l’usine est démontée et transportée pièce par pièce à Spire, sur le lieu de l’actuel musée. On y produisit alors des avions de chasse dans un grand hall qui reprend la structure de la gare de Lille (d’où son nom de Liller Halle). Après la guerre, l’usine fut démontée par les Français qui occupèrent la rive gauche du Rhin jusqu’en 1930. Le site reprit du service à l’époque des nazis qui y firent construire des avions bombardiers (Junkers et Heinkel). À nouveau réoccupée par les Français après la guerre, jusqu’en 1985, date de leur départ de Spire, l’usine fut à nouveau et définitivement démontée. À partir de cette date, la ville de Spire, nouveau propriétaire des lieux, entreprit de construire un musée tout entier dédié aux transports. Grâce à une collaboration internationale et à un financement adéquat, le musée put acquérir de nombreux modèles de différents pays (URSS puis Russie, Etats Unis, Royaume Uni, France, et même Chine)
Après le repas pris dans un restaurant traditionnel, nous entreprîmes la visite-découverte de Spire. Des traces de la ville antique et médiévale, il n’y en a plus ! Et pourtant, les hommes ont occupé le site depuis la fin du néolithique. La ville s’enorgueillit d’être doublement millénaire, mais pendant des siècles, elle n’est restée qu’à l’état de petite bourgade, issue d’un camp de légionnaires romains auquel s’est adjoint à la fin du Ier siècle, un petit centre administratif (vicus). Même l’arrivée des Francs (Franconiens) ne changea guère son destin. Il faut attendre le Moyen Age (à partir du XIIIe siècle) pour voir la ville croître de manière significative sous l’effet du commerce des draps, produits et teints sur place (garance) puis exportés. Les exportations de vin contribuèrent aussi à la prospérité de la ville. Ce n’est pas un hasard si les évêques de Spire prirent l’habitude, lors de la cérémonie de leur intronisation, de permettre à la population de boire du vin versé dans une immense vasque en forme d’écuelle contenant 1500 litres, reposant sur un pilier en pierre. Ce Domnapf se situe devant la façade de la cathédrale. Le nom même (Domnapf signifiant chapiteau de la cathédrale) suggère un autre rôle. Son emplacement, devant la cathédrale, marquait la limite territoriale entre le domaine épiscopal et le domaine laïc ; il affirmait le pouvoir de l’évêque en interdisant à toute autorité de poursuivre une personne qui viendrait chercher protection auprès de l’évêque.
Trois dates ont marqué le destin de la ville, tant sur le plan local que national. En premier lieu : 1030 avec le début des travaux de construction de la cathédrale romane, à l’initiative de l’empereur salien Conrad II. Une œuvre à la fois architecturale et politique. Sur le plan technique, elle constitue un modèle, largement imité dans le monde germanique des XIIe-XIIIe siècles : sa parfaite symétrie entre les massifs oriental et occidental (deux tours et un dôme pour chaque partie), le volume intérieur dégageant une forte impression de solennité, la clarté de la nef dont la hauteur (33m) fut permise par le système à double travée où chaque voûte d’arête s’étend sur deux travées ; les piliers supportant la charge des voûtes étaient agrandis, chacun par un dosseret, formant un système de contreforts intérieurs ; un tel système autorisait l’intégration de fenêtres à claire-voie sans affaiblir la structure. Sur les murs extérieurs, la galerie naine courant à la base du toit constitua un autre élément architectural largement copié dans des édifices ultérieurs. Les travaux s’étalèrent sur deux périodes (1030-1061 et 1090-1103) sous le règne des empereurs Saliens. La cathédrale est placée sous le vocable de Notre-Dame de l’Assomption (patronne de Spire) et de Saint Etienne. Elle est communément appelée Kaiserdom (Cathédrale impériale).
L’édifice constitua aussi un enjeu politique entre le pouvoir impérial et la papauté qui n’apprécia pas qu’une telle cathédrale, imposante par ses dimensions (133 m de longueur, 43 m de largeur) puisse avoir été décidée par le pouvoir impérial dans un village aussi peu peuplé (500 habitants environ) et destinée à servir de tombeau aux souverains Saliens. Le contexte était à l’affrontement entre ces deux pouvoirs, opposition qui éclata ouvertement avec la Querelle des Investitures en 1075. Cet antagonisme violent valut à Henri IV d’être excommunié. Aussi lorsqu’il décéda en 1106, il ne put être inhumé dans la nef. Par un subterfuge, son corps fut déposé dans une chapelle latérale de la nef (Sainte Afre) qui n’avait pas été consacrée lorsque la cathédrale fut inaugurée en 1061 (on ne la visite plus aujourd’hui). Cinq ans plus tard, l’excommunication ayant été levée, le sarcophage put être déplacé dans la nef. D’autres empereurs (Rodolphe Ier de Habsbourg notamment) ainsi que trois rois de Germanie qui ne purent accéder à la dignité impériale, furent également inhumés dans la nef.
Bien entendu un tel édifice subit les outrages du temps et des restaurations furent nécessaires. Ce fut le cas notamment en 1689 lorsqu’une partie de la nef s’effondra suite à un incendie provoqué par les troupes françaises et que le massif occidental fut remanié à la mode baroque. Les importants travaux des XIXe et début XXe siècles permirent de lui faire retrouver la structure et l’atmosphère intérieure d’origine. Au cours des fouilles entreprises dans la nef à cette époque, les sarcophages furent mis à jour et les corps identifiés. Ils furent transférés en 1906 dans la crypte, sous l’autel principal. Nous pûmes facilement les identifier grâce à une brochure remise à l’accueil. La crypte est en soi un joyau architectural roman, imposant par ses dimensions (850m2, 7m de hauteur) avec une alternance de blocs de grès de couleur jaune et rouille. . C’est la plus grande construction romane de ce type en Europe. Le groupe fut particulièrement émerveillé par une telle architecture souterraine.
Le grand incendie de la ville provoqué par les troupes françaises de Louis XIV en 1689 constitua le second point de repère. En effet, à de rares exceptions, c’est toute la ville médiévale qui disparut en cendre. La porte d’entrée de la ville, située au bout de la grand-rue fut épargnée, en même temps que la cathédrale. Les conditions de la préservation de cette porte lui épargnant un dynamitage programmé par le maréchal Duras, commandant les troupes, sont dues à l’intervention des sœurs carmélites qui n’hésitèrent pas à se jeter aux pieds du maréchal, l’implorant d’épargner la construction. Dès lors la porte prit le nom d’Altpörtel (vieille porte) avec ses deux faces bien distinctes (côté campagne et côté ville). Il reste aussi un vestige de la maison Retscher, jouxtant l’église de la Trinité, que certains considèrent encore – à tort- comme le lieu où se serait tenue la Diète de 1529.
Toutes les constructions qui s’échelonnent le long de la Maximilian strasse, ancienne grand-rue médiévale, rebaptisée en 1815 du nom de Maximilian Ier, premier roi de Bavière, sont de facture postérieure au XVIIe siècle. Certaines comme l’Hôtel de ville et l’ancien Hôtel de la monnaie furent (re)construits au XVIIIe siècle en style baroque. D’autres remontent à la période bavaroise du XIXe et début XXe siècle comme l’ancienne poste (1901). Depuis la célébration du deuxième millénaire de la fondation de Spire, à la fin du siècle dernier, la rue est entièrement piétonne. Nous pûmes la parcourir sur ses 700m en toute tranquillité, contemplant au passage quelques maisons reconstruites dont l’une – fait rarissime – est à colombages.
Nous consacrâmes une bonne partie de la visite aux deux églises luthériennes qui marquent le paysage spirois. Car Spire joua un rôle très important dans la diffusion du protestantisme. En 1529 s’est tenue dans la ville la fameuse Diète qui fut à l’origine du mot « protestant ». Cette date constitua notre troisième repère historique. Les premiers lieux de culte ayant eux aussi disparu dans l’incendie de 1689, il fallut les reconstruire. Ce fut le cas de l’église de la Trinité (Dreifaltigkeitskirche) reconstruite de 1701 à 1713 par les protestants revenus de leur exil de Francfort sur le Main. L’église est étonnante par le foisonnement des décors peints sur bois que ce soit sur le plafond de la nef (scènes de la vie du Christ) ou le long des galeries superposées (scènes de l’Ancien et du Nouveau testament). Malheureusement une porte en verre fermée ne nous permit de voir la richesse du décor que de l’entrée de la nef. À proximité, nous vîmes le clocher de deux autres églises luthériennes, témoignage d’une forte présence protestante dans la ville (30% des habitants selon un sondage récent pour 36% de catholiques).
Notre visite à Spire se termina à l’église protestante de la Commémoration (Gedächtniskirche), construite en style néo-gothique entre 1893 et 1904, pour commémorer la Diète de 1529. La communauté protestante de la ville entendait, dans un siècle dominé par un fort courant nationaliste, mettre en valeur la part du protestantisme dans la constitution de l’empire allemand, nouvellement créé (l’empereur était de confession luthérienne). La proclamation de l’infaillibilité pontificale (1870) apporta un surcroît de motivation. Le projet était ambitieux avec une nef devant contenir 1500 places, haute de 24m et un clocher culminant à 100m de hauteur. Il fallut trouver un financement à la hauteur du projet. Les ressources locales ne suffirent pas ; l’empereur apporta sa contribution, en demi-teinte : il n’était pas favorable au parti pris architectural (néo-gothique) des architectes. Il finança malgré tout l’achat des vitraux du chœur et ne vint qu’une fois dans l’église, en 1917 seulement. Il n’était pas présent le jour de l’inauguration de l’édifice. Il fut fait appel à l’étranger, comme en témoignent les inscriptions gravées sur les bancs de l’église et rappelant l’origine des dons (familles ou villes).
Le message politico-religieux se trouve essentiellement sous le clocher, à l’entrée de l’église où fut placée au centre une statue de Martin Luther, entourée des statues des cinq princes allemands qui « protestèrent ». Sur un des vitraux garnissant ce vestibule, Martin Luther est représenté en train de déchirer la bulle de son excommunication, prononcée le 3 janvier 1521.
Nous aurions aimé visiter, en face de l’édifice, l’église catholique Saint Joseph (saint patron du Palatinat) , qui fut en son temps (1912-14) une réponse des catholiques spirois à la construction de l’église de la Commémoration. Malheureusement elle était fermée et nous ne pûmes admirer l’éclectisme de cet édifice, mêlant tous les styles historicistes, en y incluant le Jugenstill. Cette église fut l’œuvre de l’architecte Ludwig Becker (1855-1840), auteur de l’église néo-romane Saint-Joseph, à Montigny-lès-Metz.
Texte : Gérard Colotte
Photographies : Dominique Mayer